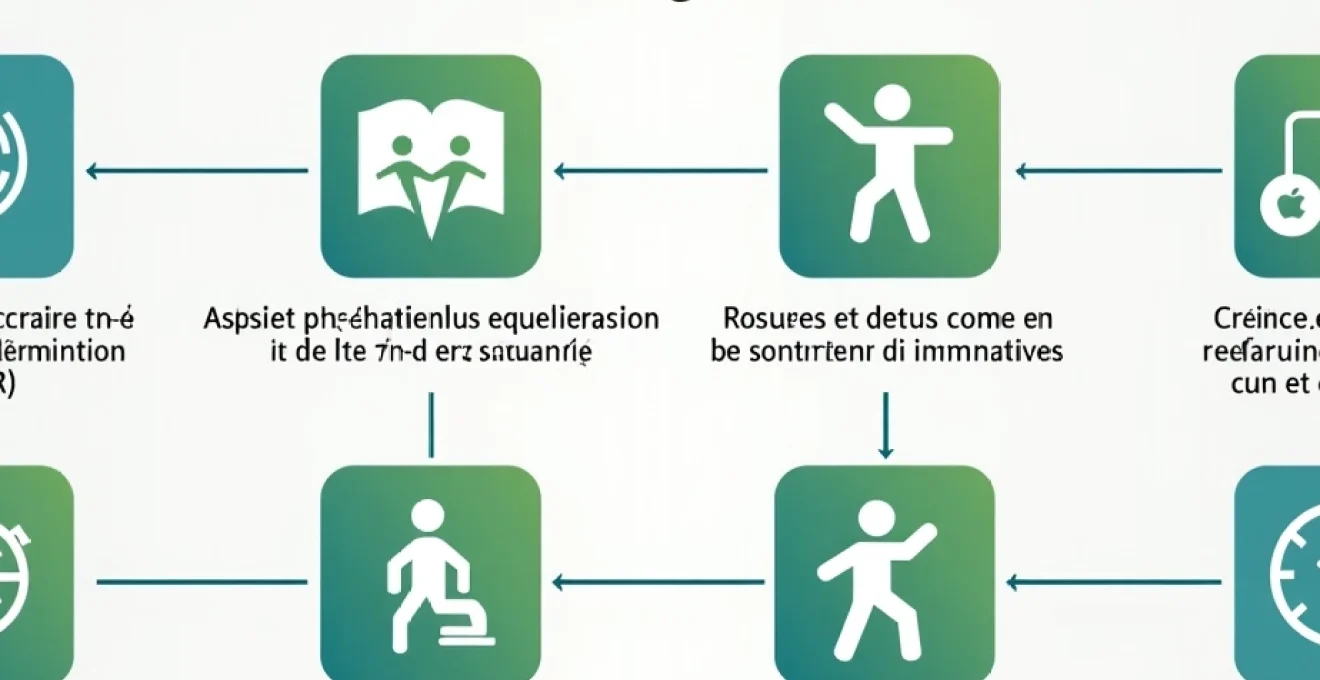
L’admission en maison de retraite, ou EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), est une étape importante dans la vie d’une personne âgée et de sa famille. Ce processus complexe repose sur une évaluation approfondie des besoins médicaux, psychologiques et sociaux du futur résident. Les critères de prise en charge sont conçus pour garantir une qualité de vie optimale et des soins adaptés à chaque individu. Comprendre ces critères est essentiel pour faciliter la transition vers ce nouveau cadre de vie et assurer le bien-être des personnes âgées dépendantes.
Évaluation gériatrique standardisée (EGS) pour l’admission en EHPAD
L’évaluation gériatrique standardisée (EGS) est la pierre angulaire du processus d’admission en EHPAD. Cette approche multidimensionnelle permet d’obtenir une vision globale de l’état de santé et des besoins du futur résident. L’EGS examine plusieurs aspects clés de la vie de la personne âgée, notamment ses capacités fonctionnelles, son état cognitif, son environnement social et ses besoins médicaux.
L’équipe pluridisciplinaire de l’EHPAD, composée de médecins gériatres, d’infirmières, de psychologues et de travailleurs sociaux, utilise des outils standardisés pour évaluer chaque domaine. Cette évaluation approfondie permet de déterminer si l’EHPAD est la solution la plus adaptée et, le cas échéant, de concevoir un plan de prise en charge personnalisé.
L’EGS est un processus dynamique qui ne se limite pas à l’admission, mais se poursuit tout au long du séjour du résident pour adapter continuellement les soins à l’évolution de ses besoins.
Critères médicaux et niveau de dépendance
Les critères médicaux et le niveau de dépendance sont des facteurs déterminants dans l’admission en EHPAD. Ces éléments permettent d’évaluer la capacité de la personne âgée à accomplir les actes de la vie quotidienne et de déterminer le niveau de soins nécessaire.
Grille AGGIR et détermination du GIR
La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) est l’outil principal utilisé pour évaluer le degré de dépendance d’une personne âgée. Cette grille permet de classer les individus en six groupes, appelés GIR (Groupes Iso-Ressources), allant du GIR 1 (dépendance totale) au GIR 6 (autonomie). La détermination du GIR est cruciale car elle influence non seulement l’admission en EHPAD mais aussi l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Les EHPAD accueillent généralement les personnes classées en GIR 1 à 4, qui nécessitent une assistance quotidienne pour les actes essentiels de la vie. Voici un aperçu des différents niveaux de GIR :
- GIR 1-2 : Dépendance sévère, nécessitant une prise en charge constante
- GIR 3-4 : Dépendance modérée, avec besoin d’aide quotidienne
- GIR 5-6 : Autonomie relative, rarement admis en EHPAD sauf situations particulières
Pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier
Les personnes âgées souffrant de pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier sont souvent prioritaires pour l’admission en EHPAD. Ces conditions peuvent inclure le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires ou respiratoires chroniques. La présence de ces pathologies requiert une surveillance médicale constante et des soins spécifiques que les EHPAD sont équipés pour fournir.
L’EHPAD dispose d’une équipe médicale sur place, capable de gérer ces conditions chroniques et d’ajuster les traitements en fonction de l’évolution de l’état de santé du résident. Cette prise en charge médicalisée offre une sécurité et une qualité de soins difficilement réalisables à domicile, surtout pour les personnes isolées ou dont les aidants sont épuisés .
Troubles cognitifs et maladies neurodégénératives
Les troubles cognitifs et les maladies neurodégénératives, tels que la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson, sont des critères importants pour l’admission en EHPAD. Ces conditions nécessitent une prise en charge spécifique et un environnement sécurisé que les EHPAD sont en mesure de fournir.
De nombreux EHPAD disposent d’unités spécialisées, comme les Unités de Vie Protégées (UVP) ou les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), conçues pour accueillir les résidents atteints de ces pathologies. Ces unités offrent un cadre de vie adapté, des activités thérapeutiques spécifiques et un personnel formé à la prise en charge de ces troubles.
Besoins en soins infirmiers quotidiens
Les besoins en soins infirmiers quotidiens constituent un critère majeur pour l’admission en EHPAD. Ces besoins peuvent inclure la gestion des traitements médicamenteux complexes, les soins de plaies chroniques, la surveillance de paramètres vitaux ou encore la gestion de dispositifs médicaux comme les sondes urinaires ou les stomies.
L’EHPAD dispose d’une équipe infirmière présente 24h/24 et 7j/7, capable de répondre à ces besoins spécifiques. Cette disponibilité constante des soins infirmiers assure une prise en charge optimale et une réactivité en cas d’urgence, offrant ainsi une sécurité que le maintien à domicile ne peut pas toujours garantir.
Aspects psychosociaux et environnementaux
Au-delà des critères médicaux, les aspects psychosociaux et environnementaux jouent un rôle crucial dans la décision d’admission en EHPAD. Ces facteurs permettent d’évaluer la qualité de vie globale de la personne âgée et sa capacité à s’adapter à un nouveau cadre de vie.
Évaluation du réseau social et familial
L’évaluation du réseau social et familial est un élément clé dans le processus d’admission. Elle permet de comprendre le niveau de soutien dont bénéficie la personne âgée et d’identifier d’éventuelles situations d’isolement social. Les assistants sociaux de l’EHPAD examinent attentivement :
- La présence et l’implication des proches dans la vie quotidienne
- La fréquence des visites et des contacts sociaux
- L’existence d’un réseau d’amis ou de voisins
- La participation à des activités sociales ou associatives
Un réseau social limité ou un isolement important peuvent être des facteurs favorisant l’admission en EHPAD, où la personne âgée pourra bénéficier d’un environnement social stimulant et d’activités régulières.
Capacité d’adaptation à la vie en collectivité
La capacité d’adaptation à la vie en collectivité est un critère essentiel pour assurer une intégration réussie en EHPAD. Les psychologues et les équipes d’animation évaluent la personnalité du futur résident, ses centres d’intérêt et sa capacité à nouer des relations sociales. Cette évaluation peut inclure :
– Des entretiens avec la personne âgée et sa famille pour comprendre ses habitudes de vie- L’observation de son comportement lors de visites préalables à l’EHPAD- L’analyse de son parcours de vie et de ses expériences antérieures de vie en collectivité
Une bonne capacité d’adaptation favorise une transition en douceur vers la vie en EHPAD et contribue au bien-être global du résident.
Risques liés au maintien à domicile
L’évaluation des risques liés au maintien à domicile est un aspect crucial de la décision d’admission en EHPAD. Ces risques peuvent être multiples et variés, incluant :
– Les chutes et accidents domestiques- La malnutrition ou la déshydratation- L’aggravation de problèmes de santé par manque de suivi médical régulier- L’isolement social et la dépression
Lorsque ces risques deviennent trop importants et que la sécurité de la personne âgée ne peut plus être garantie à domicile, l’admission en EHPAD devient une option sérieuse à envisager. L’EHPAD offre un environnement sécurisé, avec une surveillance constante et des équipements adaptés pour prévenir ces risques.
L’évaluation des risques à domicile doit être réalisée de manière objective, en impliquant la personne âgée, sa famille et les professionnels de santé, pour prendre une décision éclairée et dans l’intérêt du bien-être de la personne.
Processus administratif et financier
Le processus administratif et financier est une étape incontournable de l’admission en EHPAD. Il permet de s’assurer que tous les aspects pratiques et financiers sont pris en compte pour garantir une prise en charge optimale du résident.
Dossier unique d’admission en EHPAD
Le dossier unique d’admission en EHPAD est un document standardisé qui simplifie les démarches administratives. Ce dossier comprend deux volets principaux :
- Le volet administratif : il regroupe les informations personnelles du futur résident, ses coordonnées, celles de ses proches, ainsi que les éléments relatifs à sa situation financière et à sa protection juridique éventuelle.
- Le volet médical : rempli par le médecin traitant, il détaille l’état de santé de la personne, ses traitements en cours et ses besoins en soins spécifiques.
Ce dossier unique permet de centraliser toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la demande d’admission et facilite les échanges entre les différents EHPAD sollicités.
Évaluation des ressources financières du résident
L’évaluation des ressources financières du résident est une étape cruciale du processus d’admission. Elle permet de déterminer la capacité du futur résident à financer son séjour en EHPAD et d’identifier les aides financières auxquelles il peut prétendre. Cette évaluation prend en compte :
– Les revenus mensuels (pensions de retraite, rentes, etc.)- Le patrimoine mobilier et immobilier- Les éventuelles assurances dépendance souscrites- La capacité de participation financière des obligés alimentaires (enfants, petits-enfants)
Cette analyse financière approfondie permet d’établir un plan de financement adapté et de prévenir d’éventuelles difficultés financières pendant le séjour.
Aides sociales disponibles (APA, ASH, APL)
Plusieurs aides sociales sont disponibles pour faciliter le financement du séjour en EHPAD. Les principales sont :
- L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : elle aide à couvrir une partie des frais liés à la dépendance
- L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) : elle peut prendre en charge une partie des frais d’hébergement pour les personnes aux ressources insuffisantes
- L’Aide Personnalisée au Logement (APL) : elle contribue à réduire les frais de logement en EHPAD
L’équipe administrative de l’EHPAD ou les services sociaux du département peuvent accompagner les familles dans les démarches pour obtenir ces aides. Il est important de noter que certaines de ces aides, comme l’ASH, peuvent faire l’objet d’une récupération sur succession.
Types d’établissements et niveaux de prise en charge
Le choix du type d’établissement et du niveau de prise en charge dépend directement des besoins spécifiques de la personne âgée, identifiés lors de l’évaluation gériatrique standardisée. Il existe différents types de structures, chacune adaptée à un profil particulier de résidents.
EHPAD médicalisés vs. résidences autonomie
Les EHPAD médicalisés et les résidences autonomie représentent deux niveaux différents de prise en charge :
| EHPAD médicalisés | Résidences autonomie |
|---|---|
| Accueillent des personnes dépendantes (GIR 1-4) | Accueillent des personnes autonomes ou peu dépendantes (GIR 5-6) |
| Présence médicale et paramédicale 24h/24 | Services médicaux limités, intervention ponctuelle |
| Prise en charge globale (soins, repas, animations) | Logements individuels avec services collectifs facultatifs |
Le choix entre ces deux types d’établissements dépend essentiellement du niveau d’autonomie de la personne âgée et de ses besoins en soins médicaux. Les EHPAD médicalisés sont plus adaptés aux personnes nécessitant une surveillance constante et des soins réguliers.
Unités de vie protégées pour résidents alzheimer
Les unités de vie protégées (UVP) sont des espaces spécialement conçus au sein des EHPAD pour accueillir les résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Ces unités offrent un environnement sécurisé et adapté aux besoins spécifiques de ces résidents, notamment :
- Des espaces de déambulation sécurisés pour répondre au besoin de marche fréquent
- Une signalétique adaptée pour faciliter l’orientation
- Des activités thérapeutiques spécifiques pour stimuler les capacités cognitives
- Un personnel formé aux techniques de communication et d’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs
Ces unités permettent de préserver l’autonomie des résidents tout en assurant leur sécurité et en limitant les troubles du comportement souvent associés à la maladie d’Alzheimer.
PASA et UHR pour les troubles du comportement
Pour les résidents présentant des troubles du comportement plus importants, deux dispositifs spécifiques existent au sein de certains EHPAD :
- Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) : ce sont des espaces dédiés qui accueillent, pendant la journée, des résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés. Ils proposent des activités sociales et thérapeutiques visant à maintenir l’autonomie et à apaiser les troubles du comportement.
- Les Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) : ces unités accueillent jour et nuit des résidents ayant des troubles du comportement sévères. Elles offrent un accompagnement renforcé et des soins adaptés dans un environnement architectural sécurisé et rassurant.
Ces dispositifs permettent une prise en charge graduée et adaptée aux différents niveaux de troubles du comportement, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents concernés et celle des autres résidents de l’EHPAD.
Critères d’urgence et situations prioritaires
Certaines situations peuvent nécessiter une admission prioritaire en EHPAD. Ces critères d’urgence sont pris en compte pour accélérer le processus d’admission lorsque le maintien à domicile devient impossible ou dangereux.
Hospitalisation prolongée et impossibilité de retour à domicile
Une hospitalisation prolongée suivie d’une impossibilité de retour à domicile constitue une situation d’urgence pour l’admission en EHPAD. Cette situation peut survenir suite à :
- Une chute grave entraînant une perte d’autonomie importante
- Une décompensation d’une maladie chronique nécessitant des soins constants
- Une intervention chirurgicale lourde suivie de complications
Dans ces cas, l’équipe hospitalière, en collaboration avec le service social, peut initier une demande d’admission prioritaire en EHPAD. Cette démarche vise à éviter une hospitalisation prolongée inadaptée et à assurer une continuité des soins dans un environnement plus approprié.
Épuisement des aidants familiaux
L’épuisement des aidants familiaux est un critère d’urgence souvent sous-estimé mais crucial dans la décision d’admission en EHPAD. Les signes d’épuisement peuvent inclure :
- Des problèmes de santé physique ou psychologique chez l’aidant
- Une incapacité croissante à gérer les soins quotidiens
- Des situations de tension ou de conflit au sein de la famille
Lorsque l’épuisement des aidants est constaté, une admission rapide en EHPAD peut être envisagée pour préserver la santé de l’aidant et garantir une prise en charge adéquate de la personne âgée. Les services sociaux et les associations d’aide aux aidants peuvent jouer un rôle clé dans l’identification de ces situations et l’accompagnement vers une solution d’hébergement adaptée.
Maltraitance ou mise en danger à domicile
Les situations de maltraitance ou de mise en danger à domicile constituent des critères d’urgence absolue pour l’admission en EHPAD. Ces situations peuvent prendre différentes formes :
- Négligence grave dans les soins ou l’alimentation
- Violences physiques ou psychologiques
- Abus financiers
- Conditions de vie insalubres ou dangereuses
Dans ces cas, les services sociaux, les professionnels de santé ou les autorités judiciaires peuvent intervenir pour organiser une admission en urgence en EHPAD. L’objectif est de mettre la personne âgée en sécurité et de lui offrir un environnement de vie adapté et bienveillant.
Il est important de noter que ces situations d’urgence nécessitent une évaluation rapide mais approfondie pour s’assurer que l’admission en EHPAD est la meilleure solution pour la personne âgée concernée.